Hygie

Dans la mythologie grecque, Hygie ou Hygée (en grec ancien Ὑγιεία / Hugieía ou Ὑγεία / Hugeía, « santé »), fille d'Asclépios (dieu de la médecine) et d'Épione est la déesse de la santé, la propreté et de l'hygiène. Le mot « hygiène » vient d'ailleurs de son nom. Elle représente la santé préservée et symbolise également la médecine préventive.
Elle correspond à Salus chez les Romains.
Rôle
Sa sœur est Panacée, qui symbolise la médecine curative. Asclépios et ses filles appartiennent à la lignée d'Apollon, dieu de l'intelligence rationnelle, qui préfigure déjà la science telle qu'on la concevra plus tard en Occident.
Les Grecs l'honoraient comme une déesse puissante, chargée de veiller sur la santé des êtres vivants. Non seulement les hommes, mais tous les animaux étaient l'objet de ses soins. C'est elle qui suggérait mystérieusement aux uns et aux autres le choix des aliments nécessaires à leur existence et les remèdes appropriés à leurs maux ; elle personnifiait en quelque sorte l'instinct de la vie et, en soutenant les forces des mortels, en prévenant même la maladie, évitait à son père la peine d'intervenir continuellement afin d'alléger ou de guérir la douleur.
Hygie fut plus tard la personnification de la lune.
Représentations

Des statues d'Hygie ont été attribuées entre autres à Scopas, Bryaxis, et Timothéos. Elle est représentée couronnée de laurier et tenant un sceptre, comme reine de la médecine. Sur son sein est un serpent à plusieurs replis, qui avance la tête pour boire dans une coupe qu'elle tient de l'autre main.
Ariphron, artiste et musicien de Sicyone du IVe siècle av. J.-C. lui adressa un hymne célèbre.
Dans l'Encyclopédie française du XIXe siècle, on la décrit comme :
- « [...] une jeune nymphe, à l'œil vif et riant, au teint frais et vermeil, à la taille légère, riche d'un embonpoint de chair, mais non chargée d'obésité, portant sur la main droite un coq et de l'autre un bâton entouré d'un serpent, emblème de la vigilance et de la prudence. »
Culte
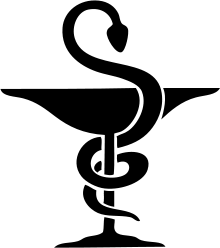
Bien que le culte d'Hygie ait été célébré localement dès le VIIe siècle av. J.-C., il ne commença à se répandre plus largement que lorsque l'oracle de Delphes la reconnut (ce fut fait après une épidémie de peste qui dévasta Athènes entre 429 et 427 av. J.-C.). Rome la reconnut pour sa part en 293 av. J.-C. Les temples principaux la célébrant ont été élevés à Épidaure, Corinthe, Cos et Pergame.
Pausanias remarqua parmi les statues d'Hygie, dans un temple d'Asclépios, à Sicyone (fondée par Alexanor, petit-fils d'Asclépios), que l'une d'elle était couverte d'un voile et que les femmes de cette ville lui dédiaient leur chevelure. Si on en croit les inscriptions, des sacrifices similaires étaient pratiqués à Paros.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Pierre Commelin, Mythologie grecque et romaine [détail des éditions] [lire en ligne]
- Portail de la mythologie grecque
- Portail de la médecine
