Amphithéâtre romain
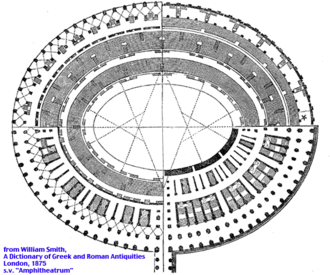
Un amphithéâtre romain est un vaste édifice public de forme elliptique, à gradins étagés, organisé autour d'une arène où étaient donnés des spectacles de gladiateurs (munera), de chasses aux fauves (venationes), ou très exceptionnellement de batailles navales (naumachia). Il en reste de très nombreux vestiges.
Historique
Origines de l'amphithéâtre



L'amphithéâtre se présente comme la combinaison de deux théâtres[1]. Il comprend une arène autour de laquelle se développent des volées de gradins. Si les premiers édifices de ce genre furent construits en grande partie en bois, par la suite ces constructions devinrent immenses, utilisant la brique et la pierre. Les plus grands d'entre eux disposaient de trois ou quatre étages d'arcades, pouvant atteindre des hauteurs considérables (57 mètres pour l'amphithéâtre flavien (Colisée de Rome).
Premières réalisations en Campanie
Dans la Rome antique, les villes de Campanie, dans le sud de l'Italie, sont les premières à construire des édifices spécifiques permanents, grâce à un aménagement du relief naturel. Cette dernière structure est appelée cavea. L'amphithéâtre de Pompéi, édifié selon ce principe vers 70 av. J.-C.[2], est le plus ancien qui soit conservé. Les édifices de Capoue et de Pouzzoles (Italie), construits à la fin du IIe siècle av. J.-C., constituent les plus anciens exemplaires de ce monument, qui avait pour destination première d'accueillir des combats de gladiateurs (munera en latin) et de fauves (venationes en latin).
Premiers édifices à Rome
L'habitude d'organiser de tels spectacles n'était pas alors une nouveauté : dès le IIIe siècle av. J.-C. des combats sont attestés lors de funérailles en Étrurie et en Campanie. À Rome même, il s'en disputa pour la première fois en 264 av. J.-C., au forum Boarium, puis à maintes reprises sur le forum lui-même. La place sous laquelle avaient été creusées des galeries de service servait d'arène. Des gradins de bois érigés à l'entour recevaient les spectateurs. Apparu tardivement, l'amphithéâtre ne s'imposa pas comme le seul cadre des chasses et des combats de gladiateurs. Le premier amphithéâtre à Rome, construit en 29 av. J.-C., fut longtemps concurrencé par le forum romain puis par le Champ de Mars.
L'amphithéâtre à partir du Ier siècle av. J.-C.
Les amphithéâtres se multiplient. L'arène revêt généralement un plan elliptique, qui est le plus favorable à la perception des spectacles par l'ensemble du public. Elle est accessible par des portes situées aux extrémités du grand axe de l'ellipse et complétées dans certains édifices par des accès sur son petit axe. Sous son sol sont aménagés à partir de l'époque augustéenne des chambres et des couloirs dont certains sont reliés à la surface par des trappes. Des monte-charges hissaient les bêtes destinées aux chasses. Une haute dénivellation couronnée d'un parapet sépare l'arène du public. Comme dans le théâtre, les gradins sont divisés horizontalement par des præcinctiones définissant des mæniana et verticalement par des escaliers rayonnants limitant des cunei. Dans les édifices les plus anciens, l'arène était parfois creusée et la cavea était adossée au terrain naturel ou reposait sur du remblai qui, compartimenté ou non, était retenu par un mur à sa périphérie. Les accès aux gradins étaient alors disposés à l'extérieur du monument. Ce mode de construction resta majoritaire jusque dans les années 60 apr. J.-C., mais fut concurrencé à partir de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. par le dispositif à structure creuse adopté dans les théâtres. Des murs rayonnants reliés par des voûtes supportaient les gradins. Des galeries périphériques et des escaliers intégrés à la substructure de la cavea conduisaient à des vomitoires. La façade externe du monument se présentait comme une superposition d’un à trois niveaux d'arcades et d'un attique décoré d'ordres engagés.
L'exemple du Colisée
L'exemplaire le plus grand et le plus élaboré de ces édifices à substructions artificielles est le Colisée. Commencé en 71 ou en 72 à l'initiative de Vespasien, il fut inauguré sous Titus par cent jours de spectacles durant lesquels furent tuées cinq mille bêtes sauvages. Le chantier fut achevé sous Domitien après plus de douze années de travaux. Son arène de 79,35 × 47,20 m était comprise dans une cavea de 187,75 × 155,60 m. Quelque cinquante-six rangées de gradins, divisées à l'image des groupes sociaux qui y siégeaient, pouvaient recevoir environ 55 000 personnes. Les premiers degrés recevaient les sièges mobiles des spectateurs de marque. Les derniers, construits en bois, étaient disposés sous un portique. La façade extérieure en travertin se composait de trois niveaux de quatre-vingts travées superposant les ordres dorico-toscan, ionique et corinthien. Un attique à pilastres corinthiens couronnait la construction. Percé de fenêtres et orné de boucliers, il portait les consoles utiles à la fixation des mâts du velum ombrageant les gradins. Un détachement de marins de la flotte était affecté au maniement des cordages de cette immense voilure. Dans son dernier état, le sous-sol de l'arène était entièrement aménagé et relié par un corridor souterrain à la grande caserne de gladiateurs située à proximité de l'amphithéâtre. L'édifice servit de modèle à de nombreux amphithéâtres construits dans l'Empire romain, sans néanmoins y imposer une uniformité planimétrique. En Gaule, il fut concurrencé par des monuments combinant une arène à une cavea incomplète. Et on pratiquait divers sports.
Construction d'amphithéâtres dans les provinces
En Orient, l'amphithéâtre connut une faible diffusion. Ils possédaient pour certains une scène et un orchestre à podium. Dans les pays où la culture grecque était bien implantée, peu d'amphithéâtres furent construits. Les théâtres et les stades furent souvent aménagés pour recevoir les spectacles de l'arène.
En revanche en Occident, où la construction de ces monuments se poursuivit de la fin du Ier siècle jusqu'au milieu du IIIe siècle, l'amphithéâtre devint le signe le plus évident de la romanisation. Mais la romanité et l'urbanité s'y exprimèrent à des degrés divers sur plusieurs aspects.
Caractéristiques des amphithéâtres gallo-romains
L'un de ces aspects notoires est l'apparition d'amphithéâtres ruraux dans les provinces occidentales plus éloignées de Rome : Gaule Lyonnaise et Aquitaine en particulier, également en Belgique. On ne les trouve pas dans le monde rural de la Gaule narbonnaise, très romanisée. Ils sont généralement associés à des thermes et des lieux cultuels (temples) comme entre autres à Sceaux-du-Gâtinais (Aquis Segeste), Areines, Montbouy, Triguères, Chevilly ou Châteaubleau pour ne citer que ceux-là[3]. Autre trait caractéristique de ces complexes sanctuaires-thermes-théâtres : on les trouve groupés en constellations le long des limites de territoires entre deux peuples gaulois[4]. Ces sites cultuels et culturels ruraux présentent l'“ anomalie ” de nécessiter une certaine organisation économique, notamment avec le théâtre, sans pour autant être liés à une population sédentaire notable : l'habitat y est très restreint voire inexistant[3].
Un autre trait remarquable des amphithéâtres dans les provinces occidentales est l'apparition d'édifices mixtes. Il ne s'agit pas tant de l'adjonction parfois ultérieure d'une arène elliptique, mais de l'agrandissement de l'orchestra : non seulement ce dernier est plus grand au point que son diamètre est toujours supérieur aux dimensions de la scène dont le bâtiment se voit notablement réduit, mais il devient elliptique jusqu'à former un cercle presque fermé[5]. On y retrouve la même distribution des portes pour les acteurs que dans le théâtre grec classique, où celles-ci s'ouvrent sur l'orchestra et non pas sur la scène comme dans le théâtre romain[4]. La cavea, quant à elle, prend une forme d'arc outrepassé et dépasse le demi-cercle[5].
Ces modifications majeures faisaient de ces théâtres des amphithéâtres hybrides, « amphithéâtres-théâtres » ou « amphithéâtres à scène ». C'est la disposition des arènes de Lutèce, Aquis Segeste, Areines, Montbouy, Triguères, Châteaubleau et bien d'autres amphithéâtres gallo-romains. Plus on s'éloigne de Rome, plus ces structures hybrides sont nombreuses[3],[5]. On en distingue d'ailleurs deux catégories : ceux convenant aux combats des jeux, où les gradins inférieurs sont surélevés pour la protection des spectateurs ; et ceux qui n'ont pas de podium et dont le bord de l’orchestre est un simple mur rectiligne - le tout très réminiscent du théâtre grec une fois de plus. Ce dernier type ne peut manifestement pas mettre des combats en spectacle ; restent alors les danses, auxquelles l'orchestre circulaire se prête bien. Le mot écrit n'étant pas le point fort des Gaulois, nul document n'atteste de l'existence de spectacles dansés dans leurs théâtres. En revanche de nombreux artéfacts pointent dans cette direction : statuettes (trésor de Neuvy-en-Sullias par exemple), peintures (nombreux tombeaux de la Gaule romaine en particulier), suggèrent des rites naturistes célébrant la fécondité - thème classique connu, également pour ses excès[4] - et, pourquoi pas, la célébration des innombrables divinités gauloises y compris celles des sources sacrées auxquelles ils ont si constamment associé leurs théâtres-amphithéâtres, allant jusqu'à bâtir certains d'entre eux en les rendant impropres à tout autre des danses ou autre spectacle similaire. Quoi qu'il en soit, l'hybridisation théâtre – amphithéâtre est un autre signe de dissociation entre le monde romanisé en profondeur et les peuples moins touchés : dans la Gaule plus éloignée de l'emprise romaine les spectacles étaient plus marqués par les danses et les jeux que par le théâtre tel que conçu par Rome[3],[5].
Au-delà de la dimension cultuelle, leur répartition géographique indique par ailleurs que ces complexes ruraux sanctuaires-théâtres-thermes existaient principalement dans des secteurs où les communautés de paysans libres étaient moins confrontées à de grands propriétaires. Conditions socio-politiques aidant, on voit alors de telles communautés prendre suffisamment d'ampleur pour devenir des villes, voire des cités - par exemple Argentomagus (Argenton-sur-Creuse) et Grand en pays leuque[6]. La distribution géographique de ces centres cultuels et culturels ruraux les lie donc à la notion de civitas[3]. Mais pour la plupart, ces centres de vie ont périclité dès le IIIe siècle et ne furent pas reconstruits[6].
On compte plusieurs centaines d'amphithéâtres à travers l'empire romain, parmi lesquels se trouvent une soixantaine d'édifices de type gallo-romain[5].
-

Vue intérieure du Colisée
-

Amphithéâtre de Pula
-

Amphithéâtre de Capoue
Les spectacles de l'amphithéâtre
L'amphithéâtre est principalement dédié aux combats de gladiateurs. La veille des combats était organisée la cena libera, un grand banquet gratuit qui pouvait être partagé avec des spectateurs qui voulaient voir la valeur des combattants.
Des batailles navales (naumachiae) pouvaient être organisées à l'intérieur de certains de ces édifices. Il existe même des aqueducs qui furent tout spécialement construits pour acheminer l'eau nécessaire au remplissage de l'arène. Ces batailles navales étaient bien sûr très prisées par le public romain, car plutôt rares. Quant aux chasses (venationes), elles consistaient en combats d'animaux contre animaux, ou d'hommes contre animaux.
Dans l'amphithéâtre avaient eu lieu aussi des exécutions de condamnés à mort («noxii» en latin), qu'on appelait «meridiani» (ceux de midi), parce que ce type de spectacle avait lieu au cours des intermèdes de midi. Notamment sous Néron, des chrétiens furent brûlés vifs. La mort des condamnés était mise en scène, parfois sous forme de contes mythologiques : toujours sous Néron, selon Suétone, on reconstitua par exemple le mythe d'Icare, qui, s'écrasa sur le sol de l'arène et couvrit l'empereur de sang[7]. Clément Ier rapporte quant à lui que des chrétiennes avaient subi le sort de Dircé[8]. Il pouvait aussi s'agir d'épisodes historiques, comme celui où Mucius Scaevola se brûlait la main[9].
Bibliographie
- Jean-Claude Golvin, L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, Diffusion de Boccard,
- Jean-Claude Golvin, L'amphithéâtre Romain et les jeux du cirque dans le monde antique, Archéologie Nouvelle, , 160 p. (ISBN 2953397353)
- Jean-Claude Golvin et Christian Landes, Amphithéâtres & Gladiateurs, Les Presses du CNRS, , 237 p. (ISBN 2876820463)
- Pierre Gros, L'architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. 1 Les monuments publics, Picard, , 503 p. (ISBN 2708406736)
- Jean-Claude Lachaux, Théâtres et amphithéâtres d'Afrique proconsulaire, Aix-en-Provence, Édisud, , 154 p.
- (de) Thomas Hufschmid, « Funktionale Gesichtspunkte des Theaters und des Amphitheaters im architektonischen, sozialen und politischen Kontext », Theatra et spectacula, vol. 1, no 2, 2011, p. 263-292 (lire en ligne)
Références
- ↑ Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, PUF, Paris, 2005, p. 99.
- ↑ Golvin 1988, p. 34
- 1 2 3 4 5 Les théâtres ruraux des Carnutes et des Sénons : leur implantation et leurs rapports avec la Civitas. Mme F. Dumasy. Dans Revue archéologique du Centre de la France, 1974, Vol. 13, n°13-3-4, pp. 195-218.
- 1 2 3 Les théâtres ruraux sacrés de la Gaule du IIe siècle. Gilbert Charles Picard. Association Orléanaise Guillaume-Budé (branche de l'Association nationale Guillaume-Budé).
- 1 2 3 4 5 Les théâtres et les amphithéâtres en Gaule. J.-F. Bradu, Professeur agrégé histoire-géographie - Orléans.
- 1 2 Montbouy et son sanctuaire de source (Loiret). Association Orléanaise Guillaume-Budé (branche de l'Association nationale Guillaume-Budé).
- ↑ Suétone, Néron, XII, 5-6
- ↑ Clément de Rome, Épître aux Corinthiens, VI
- ↑ Martial, VIII, 30
Liens externes
- (fr) Les théâtres et amphithéâtres antiques
- (fr) Amphithéâtre et spectacles
- Portail de la Rome antique
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’archéologie

